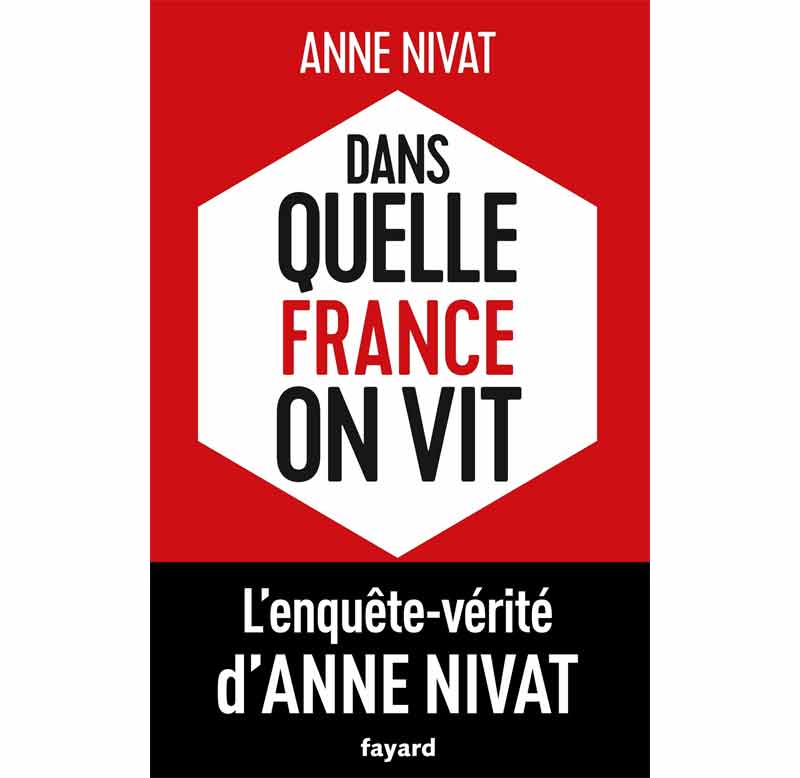Anne Nivat : Dans quelle France on vit ? La France. La connaît-t-on ? Anne Nivat est grand reporter et écrivain. Elle sillonne en toute indépendance les terrains les plus violents de la planète.
La France. La connaît-t-on ? Comment la raconter ? Anne Nivat, reporter de guerre, familière des lointains conflits en terres irakienne, afghane ou tchétchène, porte pour la première fois son regard sur l’Hexagone. Pour cette immersion dans six villes de France, à l’heure où les journalistes sont parfois taxés d’arrogance, la reporter de terrain se place à hauteur de ces femmes et de ces hommes côtoyés durant des semaines, chez qui elle a vécu.
À Évreux, Laon, Laval, Montluçon, Lons-le-Saunier, Ajaccio, tous lui ont confié leurs préoccupations, leurs projets, lui ont donné à voir leur vie. Qui sont ces Français « oubliés » que l’on accuse parfois de « mal voter » et qu’on ne va jamais rencontrer ? Ils ont évoqué ensemble le sentiment de déclassement et celui d’insécurité, le poids du chômage, le malaise des jeunes, le questionnement sur l’identité. Reconversions réussies, humour et espoir jalonnent aussi cette enquête. À mille lieues des discours stéréotypés charriés par la campagne électorale de cette année 2017, ce récit, dénué de préjugés, sonne « vrai » parce qu’il a été recueilli sans hâte et sans tabou, avec honnêteté, respect et minutie.
AVANT-PROPOS
Il y eut ces mots du chef de l’État français, prononcés le 16 novembre 2015 devant les parlementaires réunis en Congrès à Versailles : « La France est en guerre. » Sur le moment, cette affirmation belliqueuse m’avait heurtée. Puis j’ai compris qu’elle exprimait l’indicible, une manière de communier face aux attaques. Nombreux furent ceux qui allaient répéter ensuite cette antienne, faute de trouver autre chose à dire.
La démocratie a le privilège de la liberté d’expression, et c’est en son nom que, depuis des années, je sillonne des terrains dangereux. Toutes les horreurs de la guerre me sont familières. D’habitude, elles ont l’élégance de se produire dans un « ailleurs » lointain où des forces armées régulières combattent djihadistes ou autres extrémistes. Or, quand des individus munis de kalachnikovs tuent, en plein Paris, un groupe d’hommes ayant ri de l’islam, il y a de quoi être désarçonné.
Longtemps ignorées par l’opinion publique française, les « guerres contre la terreur » nous avaient rattrapés. Nous, reporters de guerre, avions eu tant de difficultés à convaincre la population de l’importance des guerres que nous couvrions – et voilà que, désormais, le pire se déroulait aussi chez nous.
L’idée simpliste que, grâce à la réponse guerrière, tout peut être réglé d’un coup de baguette magique est un leurre. Jamais nous ne devrions céder à la simplification. Depuis ma confrontation avec mon premier terrain de guerre, la Tchétchénie, en 1999, je sais que la violence en un territoire donné ne se cantonne jamais à celui-ci : elle se diffuse comme l’eau sous la terre, se ramifie et s’approfondit, autant qu’elle divise les hommes en une myriade de camps retranchés se faisant face.
J’ai longtemps été stupéfaite, voire blessée, d’entendre des voix amies affirmer ne pas comprendre pourquoi je continuais à donner la parole à l’autre, celui qui fait peur, le « djihadiste », le « taliban » ou le « combattant de l’islam », bref, celui que nos forces alliées avaient pour mission d’aller dénicher et combattre. Je déplore que la volonté de connaître son « ennemi », celui qui ne pense pas comme nous, soit non seulement si peu partagée, mais entraîne un tel déferlement de haine sur les réseaux sociaux. La haine est aussi la première motivation des terroristes français, fascinés par ces guerres lointaines d’Afghanistan, de Syrie et d’Irak, autant de conflits qui resurgissent chez nous, tels d’impitoyables boomerangs.
Bien avant les attentats qui ont endeuillé notre pays en 2015, j’avais ressenti le besoin de réaliser en France ce que je pratique d’habitude sur des terrains de guerre : un long reportage en immersion. Si l’idée d’écrire Les Passagers du Roissy-Express, un récit s’arrêtant sur toutes les stations d’une ligne de RER pour savoir « comment on vit à une demi-heure des tours de Notre-Dame », était venue à feu l’écrivain François Maspero, Dans quelle France on vit s’est peu à peu imposé à moi au fil de mes retours de zones de guerre. La banalité de la violence subie sur le terrain m’avait conduite à porter un certain regard sur les actes de terreur commis ici.
Le Nouvel Observateur de février 2006 redoutait une « montée de l’intégrisme » – à l’époque, personne ne parlait encore de « radicalisation ». À partir de début 2014, à la suite du naufrage qui avait provoqué plus de trois cent soixante morts au large de l’île de Lampedusa, les sujets sur les migrants se multiplièrent. Dès lors, les articles sur « les routes de l’immigration » ne cesseraient plus. Dans les opinions publiques occidentales, le rejet des migrants évoluait en fonction de l’intensité de la couverture médiatique à leur propos, au point que Le Monde et d’autres médias s’étaient mis à souligner la « libération de la parole xénophobe ».
Pendant mon enquête en France, colère et rancune vis-à-vis de « ceux qui décident là-bas, à Paris », de « ceux qui s’en foutent de nous », de « ceux qui ne peuvent pas comprendre », n’avaient cessé de gronder. Leur sentiment de travailler pour rien, leurs difficultés au quotidien, les normes imposées par Bruxelles, tout pesait sur ceux qui ne parvenaient pas à accepter de partager le « peu » qu’il leur restait. Certains jeunes iraient voter Marine Le Pen parce que ce vote leur paraissait « révolutionnaire », à leurs yeux celui du vrai changement. D’autres le feraient par exaspération, parce qu’ils redoutaient d’être abandonnés, ou parce qu’ils se sentaient déjà abandonnés. Que le FN n’ait pas été capable de remporter une seule région lors des scrutins régionaux de 2015 avait nourri la frustration de ses électeurs, furieux de leur non-représentation dans le paysage politique français.
Dès mes débuts sur les terrains de guerre de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, j’avais senti que ce qui se passait ailleurs, « loin de chez nous », avait et aurait des conséquences au cœur même de la bulle occidentale tissée d’illusion de puissance, d’obsession du confort et de la modernité. On avait depuis longtemps fermé nos yeux, bouché nos oreilles et envoyé des militaires français sur des terrains hostiles sans en débattre au préalable ; on s’était précipité dans l’action sans jamais envisager l’après. On modifiait les stratégies au gré des échecs subis sur les « théâtres d’opération » ; pis, à la tête de l’État, on se laissait influencer par quelques « intellectuels », prêts à tout pour s’assurer une surmédiatisation immédiate et une place dans l’histoire.
Peu désireux de connaître et de mesurer ce qui était en train de se tramer dans les esprits de ceux qui nourrissaient à notre égard une telle haine, au point de vouloir mourir en nous tuant, on avait pratiqué, ni plus ni moins, la politique de l’autruche. Or, il s’agissait de jeunes pour la plupart nés et éduqués en France, qui avaient cherché du travail en France et fini par se retrouver hors des circuits « normaux ».
Qu’il est désagréable de se regarder dans un miroir reflétant notre capacité à produire terreur et inhumanité ! D’autant que personne n’a la moindre idée de ce qu’il faudrait faire ou dire. Les politiques commentent, mais, en réalité, ne savent pas plus quoi faire. Au lendemain du massacre du Bataclan, le grand reporter britannique Patrick Cockburn martelait que « pour le moment, nous n’arrivons pas à enrayer cette menace parce que nous refusons d’en accepter la nature. Il savait que Daech fonctionnait comme un État, avec force et puissance, et qu’il était temps de s’en rendre compte.
Anne Nivat
Anne Nivat est grand reporter et écrivain. Elle est une spécialiste reconnue de la Russie où elle a habité dix ans (jusqu’en 2006). Depuis le séisme du 11-Septembre, Anne Nivat sillonne en toute indépendance les terrains les plus violents de la planète. En Tchétchénie, en Afghanistan, au Pakistan, elle continue de travailler à sa façon : en donnant la parole à ceux qui ne l’ont pas et en revendiquant le droit à la lenteur et à la complexité, en refusant la précipitation, les stéréotypes et la course au scoop. Anne Nivat a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Chienne de guerre (Fayard, 2000), pour lequel elle a reçu le Prix Albert-Londres ; Algérienne, en collaboration avec Louisette Ighilahriz (Fayard, 2001) ; La Guerre qui n’aura pas eu lieu (Fayard, 2004) ; Lendemains de guerre (Fayard, 2004) ; Islamistes : comment ils nous voient (Fayard, 2006) ; et Par les monts et les plaines d’Asie centrale (Fayard, 2006).